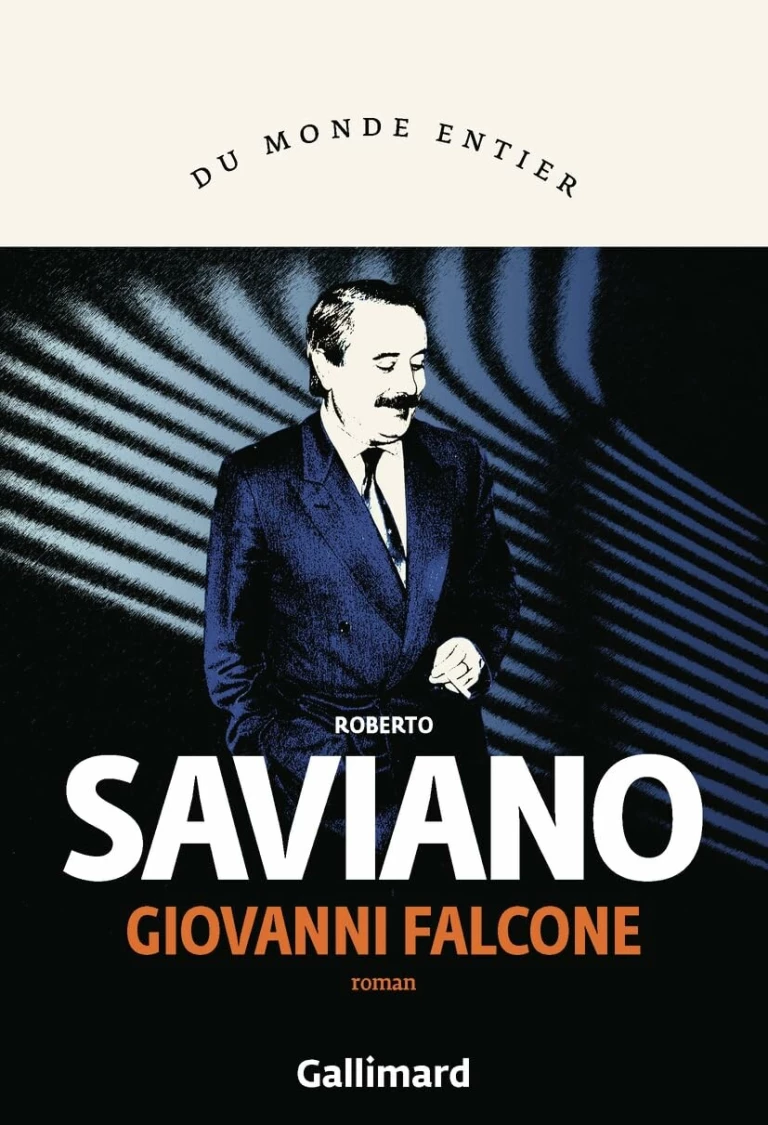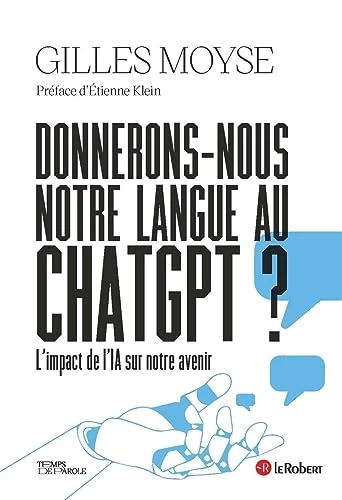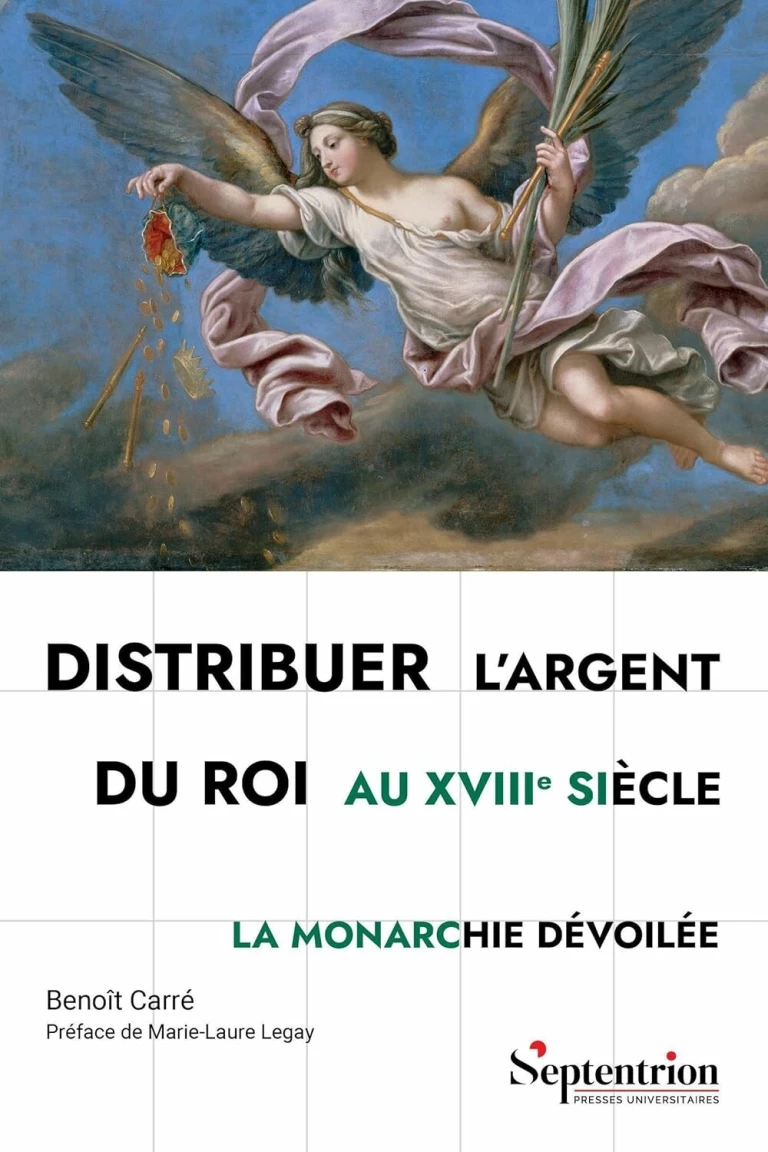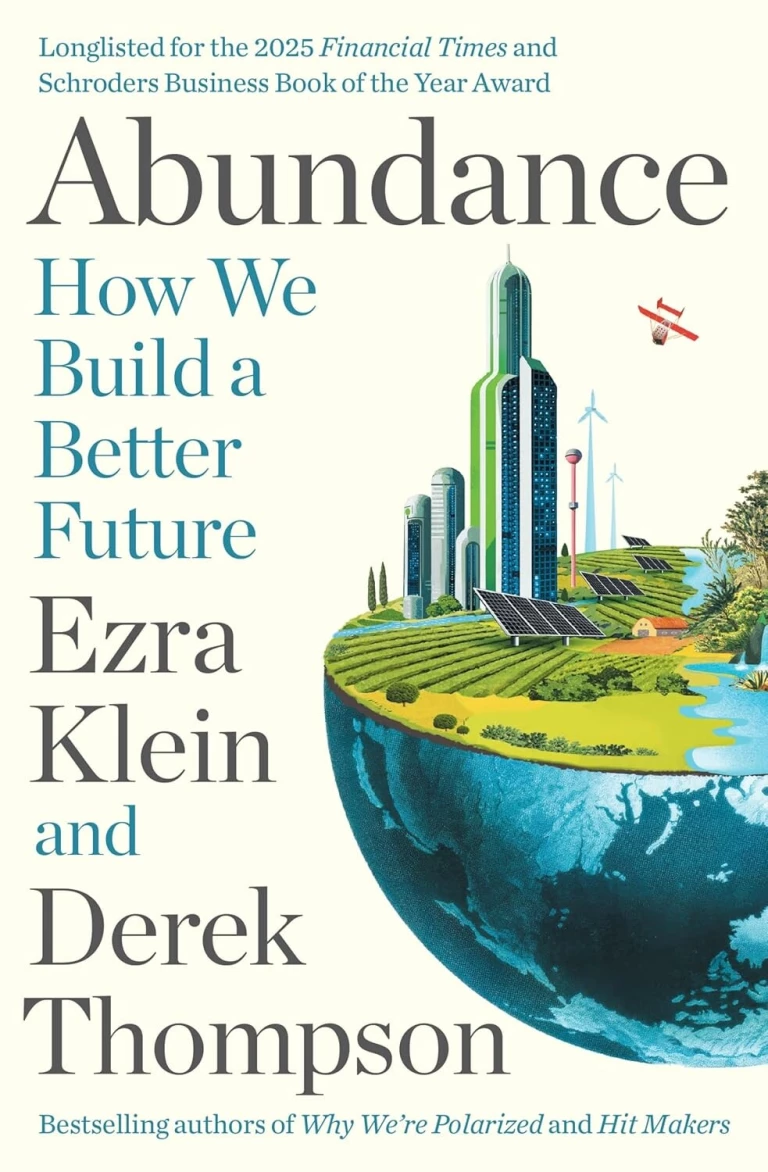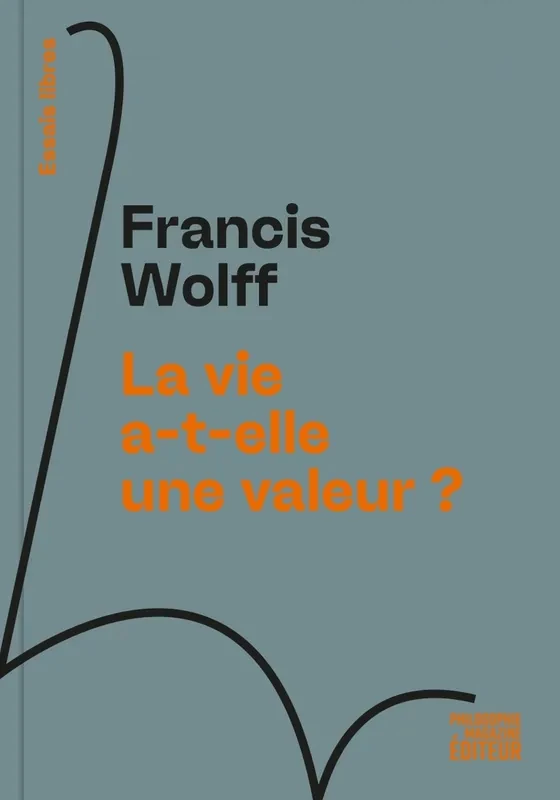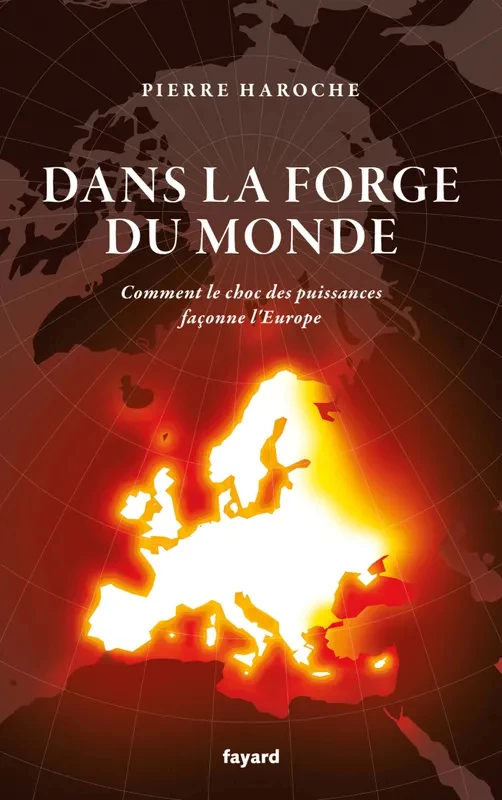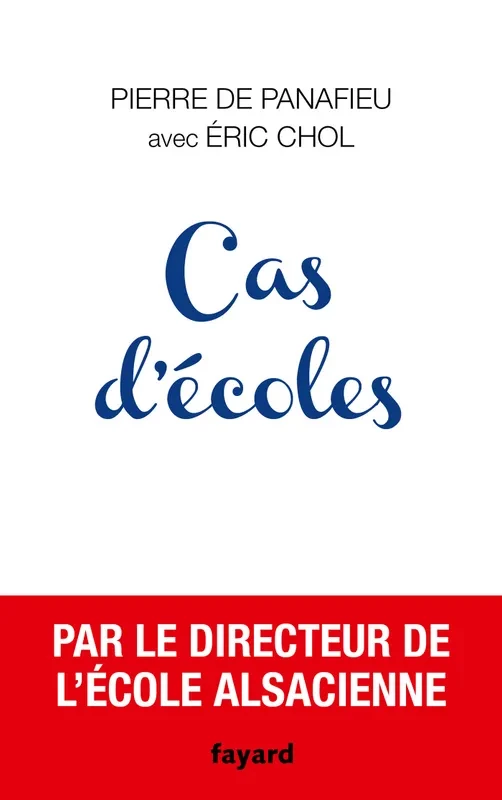Livres recommandés par Antoine Foucher
Giovanni Falcone Roberto Saviano
Le 23 mai 1992, aux abords de Palerme, plusieurs centaines de kilos d'explosifs faisaient sauter la voiture du célèbre juge Falcone, l'ennemi numéro1 de la mafia sicilienne. Le nouveau roman-enquête de Roberto Saviano reconstitue les étapes qui ont mené à cet assassinat. Tout commence vingt ans plus tôt, lorsqu'un magistrat inconnu rouvre le dossier antimafia. Sous la surveillance d'une escorte grandissante, Giovanni Falcone accumule une infinité de preuves, pleure la mort de collègues tombés avant lui et connaît quelques brèches de bonheur en tant que mari, frère et ami. À chaque instant, il sait ses jours comptés. En plusieurs chapitres haletants qui composent une mosaïque contrastée, Roberto Saviano décrit les multiples tentacules de la pieuvre mafieuse. Il rend aussi un hommage bouleversant à son antidote le plus pur : le courage d'avancer, malgré la peur, jusqu'à obtenir justice.
Antoine Foucher : Je recommande ce livre de Roberto Saviano parce qu’il parvient à faire revivre, avec une intensité presque physique, la trajectoire de Falcone et de ceux qui l’ont accompagné dans son combat contre la mafia. Saviano raconte non seulement l’homme, mais tout un collectif d’amis, de magistrats, de policiers qui ont vécu quinze années avec la certitude intime qu’elles se termineraient par leur mort. Ils se représentaient leur action comme une course de relais : chacun courait aussi loin qu’il le pouvait, sachant qu’il tomberait tôt ou tard, et la seule question était de savoir à qui l’on passerait le témoin. Cette conscience de la fin, acceptée presque sereinement, conduit certains d’entre eux à renoncer à fonder une famille pour ne pas laisser derrière eux des veuves ou des orphelins. Ce que Saviano décrit là est d’un courage bouleversant, un courage nu, presque insoutenable, parce que vécu au quotidien, dans une tension permanente. Et ce récit résonne d’autant plus aujourd’hui que Saviano lui-même, intervenant récemment à propos des assassinats de Marseille, établit un parallèle saisissant entre ce qui s’y installe et la Sicile des années 1980. Ce miroir tendu entre deux époques et deux territoires rend son livre indispensable à qui veut comprendre comment la violence se structure — et comment certains décident de l’affronter coûte que coûte.
François-Xavier Bellamy : La biographie de Giovanni Falcone par Roberto Saviano. Saviano c'est celui qui a écrit Gomorra. C'est un très beau livre sur le courage d'un magistrat face à la mafia. Et c'est un livre qui n'est pas du tout simpliste. Ce n'est pas blanc et noir, les gentils et les méchants. C'est vraiment un livre sur le courage et sur la peur. Et sur le découragement. Et sur ce que ça veut dire de se sentir presque impuissant face à des tendances profondes à l'œuvre dans une société qu'on ne peut pas se résigner à accepter pourtant. C'est vraiment un très beau livre. J'aime beaucoup Saviano.
Recommandé par : Antoine Foucher (et aussi par François-Xavier Bellamy, Rebecca Manzoni, Augustin Trapenard)
Donnerons-nous notre langue au ChatGPT ? - L'impact de l'intelligence artificielle sur notre avenir Gilles Moyse
Une réflexion lumineuse et captivante sur les enjeux liés à l'IA et l'arrivée de ChatGPT. L'invention de ChatGPT est comparable à l'invention de l'imprimerie et d'Internet. Elle serait même, selon l'auteur, aussi révolutionnaire que le fut l'invention de l'écriture...
Dans un contexte effervescent, où les critiques fusent souvent sans discernement ni rationalité, cet ouvrage apporte des éléments de réponse indispensables. Comment fonctionnent les nouvelles formes d'intelligence artificielle ? Que faire concrètement avec ces outils ? Quelles perspectives ouvrent-ils ? Mais aussi : quels impacts ont-ils sur la vie des citoyens, sur leur environnement professionnel et, plus largement, sur la démocratie et les équilibres économiques et géopolitiques ? Enifn, comment l'Europe peut-elle répondre à l'enjeu central de son autonomie numérique ?
Un essai capital pour sortir de la fascination, éveiller les consciences et (enfin) comprendre le dessous des cartes.
Gilles Moyse est docteur en Intelligence Artificielle. Il a créé une startup d'IA dédiée au traitement du langage et des documents. Il a enseigné l'IA à Sciences Po et à l'ESCP.
Antoine Foucher : Je recommande ce livre de Gilles Moyse, publié aux éditions Le Petit Robert. C’est le premier livre qui m’ait vraiment permis de comprendre, en quelques heures seulement, ce qu’est l’intelligence artificielle. Je ne suis pas ingénieur, et je m’agaçais de lire beaucoup sur le sujet sans jamais saisir comment tout cela fonctionnait. Gilles Moyse remonte à la machine de Turing et explique, avec une clarté remarquable, les fondements techniques de l’IA sans jamais employer de jargon. C’est un ouvrage lumineux : il rend accessibles les mécanismes de l’intelligence artificielle et permet, une fois les bases comprises, d’aborder autrement les grands enjeux qu’elle soulève — productivité, emploi, souveraineté. L’auteur s’appuie sur des études récentes, mais toujours dans un langage limpide. Une lecture idéale pour ceux qui veulent comprendre ce phénomène de l’intérieur, sans être des spécialistes.
Recommandé par : Antoine Foucher
Episode : Bilan de l’examen du Projet de Loi de Finances - Le nouvel esprit public
Distribuer l'argent du roi au XVIIIe siècle : La monarchie dévoilée Benoît Carré
Sous l’Ancien Régime, les finances du roi de France étaient nimbées de secret jusqu’au jour où le célèbre Necker décida de publier le montant estimé des recettes et surtout des dépenses de la monarchie. Le public découvrit alors le montant faramineux des pensions que Louis XVI payait à une grande partie de la noblesse. À la Révolution, l’Assemblée nationale décida d’enquêter puis révéla la manière dont les fonds publics tirés de la contrainte fiscale avaient pu servir à subventionner des courtisans. C’est à la fois l’histoire de cette enquête mais aussi celle de l’objet enquêté que ce livre propose de faire découvrir au lecteur. En décrivant pour la première fois, grâce à des archives inédites, les usages de cette pratique sociale qui liait le roi à la noblesse, l’auteur jette un regard nouveau sur les ressorts de la crise finale de l’Ancien Régime et retrace la genèse du premier système de retraite de la fonction publique d’État.
Antoine Foucher : Je recommande cette enquête historique sur les années 1780-1791 autour de la question des pensions versées par le roi. J’avoue que je n’avais pas mesuré à quel point ce sujet était central à l’époque : il ne s’agissait pas seulement de finances publiques, mais aussi des pensions accordées à la cour et à tous ceux qui avaient rendu service au roi. Benoît Carré (pas celui qui travaille pour notre émission) a dépouillé de nombreuses archives et restitue avec précision l’ambiance du royaume et les crispations autour de cette question : qui reçoit ces pensions et pourquoi ? On y découvre les techniques de Necker, qui, comme aujourd’hui, choisit de dire la vérité pour choquer l’opinion et provoquer la réforme. On voit Louis XVI tenter de remettre de l’ordre pour sauver les finances. Ce qui est particulièrement fascinant, c’est la fin de ce système : à la veille de la Révolution, la noblesse militaire de province, peu gratifiée en pensions, s’allie avec le tiers état contre la noblesse de cour, oisive et privilégiée. Cette alliance contribue à la dynamique révolutionnaire et aboutit à la mise en place de finances publiques plus modernes et plus transparentes.
Recommandé par : Antoine Foucher
Episode : Lecornu et la quadrature du cercle - Le nouvel esprit public
Abundance Ezra Klein, Derek Thompson
The threat to liberal democracy isn't just autocrats - it's a lack of effective action by so-called progressives. We have the means to build an equitable world without hunger, fuelled by clean energy. Instead, we have a politics driven by scarcity, lives defined by unaffordability and public institutions that no longer deliver on big ideas. It's time for change. Bestselling authors Ezra Klein and Derek Thompson have spent decades analysing the political, economic and cultural forces that have led us here. In this once-in-a-generation intervention, they unpick the barriers to progress and show how we can, and must, shift the political agenda to one that not only protects and preserves, but also builds. From healthcare to housing, infrastructure to innovation, they lay out a path to a future defined not by fear, but by abundance.
Antoine Foucher : Je voudrais recommander ce livre, présenté aux États-Unis comme le nouvel évangile de la gauche américaine ou des Démocrates, d’Ezra Klein et Derek Thompson. Il n’a pas encore été traduit en français, mais l’avantage des sciences humaines en anglais, c’est que ça se lit beaucoup plus facilement que de la littérature. Et c’est intéressant pour trois raisons. La première, c’est qu’il vient de la gauche ; la deuxième, c’est la vivacité et la lucidité de la critique de la gauche sur la gauche, en donnant des chiffres assez cruels, c’est une critique très violente et documentée. La deuxième raison, c’est que la solution ne consiste pas à distribuer de l’argent. Parce que l’argent ne sert à rien quand il n’y a pas assez de biens. Ça ne sert à rien de donner de l’argent aux gens pour acheter des logements si on ne construit pas assez de logements. Et la troisième raison, c’est que l’auteur s’en sort par un espèce de technomessianisme en disant que si les États-Unis investissent sur la technique, elle nous sauvera. Donc, le monde qu’il trace n’est pas enviable. Mais quand même, la lucidité sur la critique et l’idée qu’il faut produire plus et arrêter de donner plus d’argent et moins de biens, est quand même intéressante.
Recommandé par : Antoine Foucher
La vie a-t-elle une valeur ? Francis WOLFF
« Proclamer l'égalité du droit à vivre de tous les vivants, c'est les empêcher de vivre »Au « nous les damnés de la terre » des mobilisations ouvrières, au « nous les Français » des exhortations nationalistes, au « nous les humains » de la tradition humaniste, il faut aujourd’hui ajouter le « nous les vivants » de la conscience écologiste. Nous sommes en effet des êtres vivants et notre sort est indissolublement lié à celui des autres habitants de la planète. Pourtant ce slogan généreux et inclusif dissimule des problèmes considérables. Tous les vivants se valent-ils ? Est-ce seulement pensable ? Et qu’est-ce que la vie ? Est-ce un processus aveugle ou une valeur sacrée ? Que devons-nous aux autres humains présents et à venir ? C’est à ces interrogations cruciales que nous invite ici le philosophe Francis Wolff dans le style vif et clair qu’on lui connaît.
Antoine Foucher : Je voudrais recommander le dernier livre de Francis Wolff. Nos auditeurs réécouteront avec plaisir la thématique enregistrée avec le philosophe il y a un peu plus d’un an, mais son dernier livre est vraiment passionnant, parce qu’on a souvent le sentiment que les vrais problèmes du pays, du monde, sont des problèmes économiques, politiques, sociaux. Et ce qu’il y a de vraiment génial dans ce livre, ce est la façon dont Wolff montre qu’il y a bien plus important qui tout cela. L’auteur mène un combat philosophique pour réhabiliter l’humanisme, est il le fait avec un exemple précis, celui de la transition énergétique, en montrant qui les mot d’ordre « sauver la planète », « sauver la diversité », « sauver la nature », sont totalement inopérants et contradictoires en eux-mêmes. Parce que le vivant, c’est la lutte, et un virus est vivant. Et donc, si on veut sauver les hommes, il faut bien tuer les virus. Sur les droits des animaux : les puces de mon chien sont totalement incompatibles avec les droits de mon chien à ne pas avoir de puces. Et donc, il montre vraiment que notre impuissance à prendre en charge la lutte contre le réchauffement climatique vient du fait que, philosophiquement, le sujet est très mal posé, de façon totalement contradictoire. Et que notre seule manière, en fait, de mener à bien cette lutte, c’est de le faire au nom des humains, et non de « la nature ». Parce que la valeur suprême est la vie humaine. En plus le livre de lit comme un roman policier …
Recommandé par : Antoine Foucher
Episode : C’est Nicolas qui paie : l’amorce d’un conflit intergénérationnel - Le nouvel esprit public
Dans la forge du Monde Pierre Haroche
Les Européens ont été les premiers à faire le tour du globe, en 1522. Ils ont donné à la mondialisation son impulsion par les voyages, le commerce et la colonisation, unifiant le monde comme leur vaste empire. Ils n’étaient pas une civilisation, ils étaient la civilisation.Aujourd’hui, ils assistent au retour du balancier : désormais, l’histoire, c’est les autres. La rivalité entre les États-Unis et la Chine relègue au second plan un Vieux Continent confronté à nouveau à la guerre contre la Russie. Voilà le phénomène que Pierre Haroche met en lumière : le rôle de plus en plus crucial de la nouvelle compétition mondiale entre puissances dans le destin européen. Sous l’effet des dernières crises, dont l’électrochoc ukrainien, les Européens sont contraints d’innover, de se repenser, pour surmonter leurs faiblesses. Une nouvelle Europe est en train de sortir de la forge du monde.Explorer cette boucle inattendue, cette valse séculaire entre deux entités titanesques – l’Europe et le monde –, tel est le projet de ce livre. Car nous sommes à la croisée des chemins. PIERRE HAROCHE est maître de conférences en Relations internationales et Sécurité internationale à l’Université Queen Mary de Londres et chercheur associé Défense à l’Institut Jacques-Delors. Auparavant, il a travaillé à l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM) et au King’s College de Londres. Ses recherches portent sur l’intégration et la sécurité européennes. Il est également l’auteur d’une anthologie sur l’idée d’Europe dans la littérature, Le Goût de l’Europe (Mercure de France, 2022).
Antoine Foucher : Je recommande très chaudement ce livre de Pierre Haroche, un chercheur universitaire qui travaille entre Paris et Londres. Il s’agit d’une histoire de la dialectique entre l’Europe et le reste du monde depuis la Renaissance. Ce recul de cinq siècles redonne de l’espoir : il est possible que la dynamique du monde nous pousse hors de la « lamentabilité » dans laquelle nous sommes aujourd’hui. L’auteur montre très bien qu’il y a trois phases. La première, qu’il appelle l’Europe impériale, où il montre — dans la lignée de Kundera — que le maximum de diversité dans le minimum d’espace, c’est l’Europe. Cela pousse les nations européennes à se confronter entre elles, jamais tranquilles derrière leurs frontières, contrairement à l’Empire chinois, par exemple. C’est ce qui les a conduites à optimiser les techniques de guerre, et à acquérir la supériorité technologique qui a ensuite permis de conquérir le monde. Puis on arrive au XXème siècle, avec les deux « suicides collectifs » des deux guerres mondiales, qui placent l’Europe dans une situation subordonnée ; elle est cependant encore un enjeu pour le reste du monde : on ne peut pas être puissant si on n’est pas en Europe. Et enfin aujourd’hui, où la situation de l’Europe laisse le monde indifférent : l’Europe provinciale. Les États-Unis s’occupent davantage de Taïwan que de l’Ukraine. D’après l’auteur cette provincialisation va nous conduire à nous rassembler, parce que c’est notre seule option pour ne pas disparaître et devenir une colonie des autres puissances du monde.
Recommandé par : Antoine Foucher
Episode : Le conclave sur les retraites - La guerre USA-Iran - Le nouvel esprit public
Cas d'écoles Eric Chol
L’école française doit faire face à un double défi : non seulement le niveau scolaire continue de baisser, mais l’égalité des chances n’est plus qu’un vœu pieu. Face à la mondialisation et à la révolution technologique, est-il trop tard pour moderniser le fameux « mammouth » et l’adapter aux défis du xxie siècle ? La renommée École alsacienne, établissement privé sous contrat avec l’État et laïque, a développé depuis sa création en 1874 ses propres recettes pédagogiques, en visant l’épanouissement des élèves dans la continuité plutôt que la sélection permanente. Fort de dix-sept années de direction de cette institution, Pierre de Panafieu propose ici, avec finesse et sans prétention, d’en faire un logiciel disponible pour tous, source d’inspiration. Car les points forts de l’École alsacienne, dans le cadre d’un système scolaire qui a explosé, peuvent nourrir la réflexion sur l’école que nous voulons pour nos générations futures. À commencer par l’autonomie de l’établissement, véritable angle mort des réformes successives alors que la décentralisation en matière éducative est plus que jamais nécessaire. Les familles ont également un rôle majeur à jouer, et il serait temps de les associer intelligemment à la formation des enfants. Ces derniers méritent enfin une école qui soit un lieu de vie, leur offrant continuité et bienveillance. Ce sont bien ces trois axes qui doivent guider les réformes à venir, afin de faire de l’école française le véritable pilier de l’économie de la connaissance. Pierre de Panafieu, ancien élève de l’École alsacienne, en est directeur depuis 2001. Éric Chol, ancien élève de l’École alsacienne, est journaliste. Il dirige depuis 2012 la rédaction de Courrier international.
Antoine Foucher : Je voudrais profiter du fait que l’on est aujourd’hui à l’École Alsacienne pour recommander le livre de son directeur, à mon sens, l’un des livres les plus éclairants sur l’histoire de l’Éducation nationale dans notre pays ; plutôt du côté de la pédagogie que des institutions. Je donne deux exemples, parce que le livre n’est pas résumable en 30 secondes. Le premier, c’est : en tant que parent, on a souvent le sentiment d’être un peu mis à l’écart par l’institution scolaire en France, surtout quand on a eu la chance d’être parent dans d’autres pays ou d’avoir été élevé dans d’autres pays. Ça vient de très loin, et de très longtemps, plusieurs siècles. Et il y a une forme de continuité entre l’institution scolaire d’aujourd’hui (qui considère les parents un peu comme des ennuyeux qui prennent trop soin de leurs enfants), l’école de la Troisième République, qui suspectait toujours les parents d’avoir peut-être voté pour l’empereur et d’être antirépublicains, et l’école des jésuites de l’Ancien Régime, qui suspectait toujours les parents d’être tentés par la Réforme. Cette continuité est extraordinairement bien montrée dans le livre. Et puis un deuxième exemple : j’ai toujours eu du mal à comprendre pourquoi, dans toutes les études internationales sur le système scolaire français, il est établi depuis des décennies que les élèves français sont ceux qui ont le moins confiance en eux quand ils sortent du système scolaire. Lisez Cas d’écoles, et vous comprendrez pourquoi.
Recommandé par : Antoine Foucher
Episode : Comment répartir l’effort du désendettement ? - Trump contre la Californie - Le nouvel esprit public
Antoine Foucher apparait dans les épisodes suivants :
Le nouvel esprit public diffusé le 23/11/2025
#430 - Y a-t-il en France une gauche de gouvernement ? - L’Algérie et la France : entente impossible, rupture improbable
Le nouvel esprit public diffusé le 02/11/2025
#427 - Bilan de l’examen du Projet de Loi de Finances
Le nouvel esprit public diffusé le 21/09/2025
#421 - Lecornu et la quadrature du cercle
Le nouvel esprit public diffusé le 07/09/2025
Après le 8 septembre, la valse des pantins ? - La Chine et les divisions occidentales
Le nouvel esprit public diffusé le 06/07/2025
#410 - C’est Nicolas qui paie : l’amorce d’un conflit intergénérationnel
Le nouvel esprit public diffusé le 29/06/2025
#409 - Le conclave sur les retraites - La guerre USA-Iran
Le nouvel esprit public diffusé le 15/06/2025
#407 - Comment répartir l’effort du désendettement ? - Trump contre la Californie
S'abonner à la newsletter
Inscrivez-vous pour recevoir les derniers livres ajoutés sur le site une fois par semaine